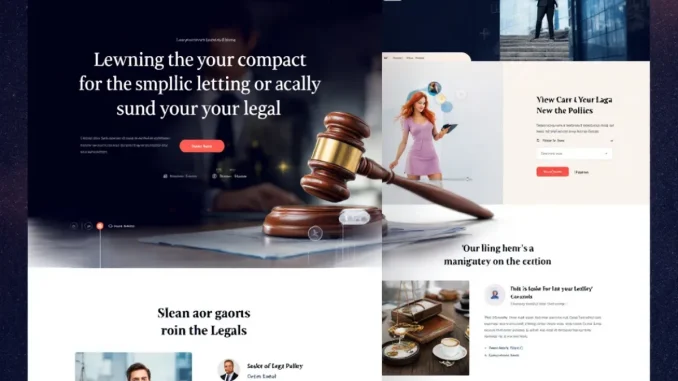
Le principe de l’application immédiate de la loi pénale plus douce, ou lex mitior, constitue un pilier du droit pénal français. Ancré dans notre tradition juridique depuis la Révolution, ce principe garantit que tout prévenu puisse bénéficier rétroactivement d’une loi nouvelle plus clémente, même si l’infraction a été commise avant son entrée en vigueur. Cette règle, d’ordre public, s’impose à toutes les juridictions et s’applique à tous les stades de la procédure pénale, y compris après une condamnation définitive. Son application soulève néanmoins des questions complexes quant à son champ d’application et ses modalités de mise en œuvre.
Fondements juridiques et philosophiques du principe de rétroactivité in mitius
Le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus douce trouve ses racines dans la philosophie des Lumières et la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il repose sur l’idée que la loi pénale doit refléter l’état actuel de la société et que nul ne doit être puni plus sévèrement que ne le ferait la société au moment du jugement.
Ce principe est aujourd’hui consacré à l’article 112-1 du Code pénal, qui dispose que « sont seules punissables les infractions légalement définies » et que « la loi nouvelle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu’elle est moins sévère que l’ancienne ».
Au niveau international, le principe est reconnu par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour européenne des droits de l’homme a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler son importance dans plusieurs arrêts, notamment Scoppola c. Italie en 2009.
La jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement précisé les contours de ce principe. Ainsi, dans un arrêt du 20 novembre 1978, la chambre criminelle a affirmé que « toute loi pénale nouvelle s’applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée, dès lors que cette loi est moins sévère que l’ancienne ».
Champ d’application : quelles dispositions sont concernées ?
Le principe de rétroactivité in mitius s’applique à un large éventail de dispositions pénales, mais son champ d’application n’est pas illimité. Il convient de distinguer plusieurs catégories :
Les lois de fond
Le principe s’applique sans conteste aux lois de fond, c’est-à-dire celles qui définissent les infractions et fixent les peines. Ainsi, si une nouvelle loi dépénalise un comportement ou réduit la peine encourue, elle s’appliquera immédiatement aux affaires en cours.
Par exemple, la loi du 10 août 2018 qui a supprimé le délit de consultation habituelle de sites terroristes s’est appliquée immédiatement, y compris aux procédures en cours.
Les lois de forme ou de procédure
En principe, les lois de forme ou de procédure sont d’application immédiate, sans considération de leur caractère plus ou moins favorable. Toutefois, la jurisprudence a admis des exceptions lorsque ces lois ont une incidence directe sur le fond du droit pénal.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que les dispositions relatives à la prescription de l’action publique, bien que de nature procédurale, devaient être soumises au principe de rétroactivité in mitius (Crim. 20 mai 2011).
Les lois d’exécution des peines
La question est plus délicate concernant les lois relatives à l’exécution des peines. La jurisprudence a longtemps considéré qu’elles échappaient au principe de rétroactivité in mitius. Cependant, cette position a évolué, notamment sous l’influence de la jurisprudence européenne.
Dans l’arrêt Del Rio Prada c. Espagne de 2013, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que les règles relatives aux réductions de peine devaient être assimilées à des règles de fond et bénéficier de la rétroactivité in mitius.
Modalités d’application : comment déterminer la loi la plus douce ?
L’application du principe de rétroactivité in mitius soulève des difficultés pratiques, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer quelle loi est effectivement la plus douce. Plusieurs critères ont été dégagés par la jurisprudence :
Comparaison globale des lois
La Cour de cassation a posé le principe d’une comparaison globale des lois successives. Il ne s’agit pas de retenir les dispositions les plus favorables de chaque loi, mais de comparer l’ensemble des dispositions pour déterminer laquelle est globalement la plus douce (Crim. 30 janvier 2002).
Prise en compte de la situation concrète du prévenu
La détermination de la loi la plus douce doit se faire in concreto, en tenant compte de la situation particulière du prévenu. Une loi nouvelle peut être plus sévère dans l’absolu, mais plus douce dans un cas d’espèce.
Par exemple, une loi qui augmenterait le quantum de la peine mais introduirait une nouvelle cause d’irresponsabilité pénale pourrait être considérée comme plus douce pour un prévenu susceptible de bénéficier de cette cause d’irresponsabilité.
Cas des lois temporaires
Les lois temporaires, c’est-à-dire celles dont la durée d’application est limitée dans le temps, posent un problème particulier. La jurisprudence considère qu’elles échappent au principe de rétroactivité in mitius, afin de préserver leur efficacité (Crim. 3 mai 1974).
Mise en œuvre pratique : à quel moment et par qui ?
L’application de la loi pénale plus douce en cours de procédure soulève des questions pratiques quant au moment de son application et aux autorités compétentes pour la mettre en œuvre.
Moment de l’application
Le principe de rétroactivité in mitius s’applique à tous les stades de la procédure, y compris :
- Pendant l’enquête
- Lors de l’instruction
- Au cours du procès
- Pendant les voies de recours (appel, pourvoi en cassation)
- Après une condamnation définitive
La Cour de cassation a même admis que le principe puisse s’appliquer après l’expiration des délais de recours, permettant ainsi la révision d’une condamnation devenue définitive (Crim. 26 février 2020).
Autorités compétentes
Toutes les autorités intervenant dans la procédure pénale sont tenues d’appliquer d’office la loi pénale plus douce :
- Le procureur de la République lors de ses réquisitions
- Le juge d’instruction dans le cadre de son information
- Les juridictions de jugement (tribunal correctionnel, cour d’assises)
- Les juridictions d’appel et de cassation
- Le juge de l’application des peines pour les mesures d’aménagement de peine
Il est à noter que le prévenu n’a pas à invoquer expressément le bénéfice de la loi nouvelle plus douce. Les juridictions doivent l’appliquer d’office, sous peine de cassation.
Enjeux et perspectives : vers une extension du principe ?
Le principe de l’application de la loi pénale plus douce en cours de procédure, bien qu’ancré dans notre droit, continue d’évoluer et de soulever des questions nouvelles.
Extension aux mesures de sûreté
La question de l’application du principe aux mesures de sûreté fait débat. Traditionnellement, ces mesures étaient considérées comme échappant à la rétroactivité in mitius. Cependant, la frontière entre peines et mesures de sûreté tend à s’estomper, comme l’a souligné la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt M. c. Allemagne de 2009.
Cette évolution pourrait conduire à une extension du principe aux mesures de sûreté, du moins à celles qui s’apparentent le plus à des peines.
Application aux personnes morales
L’application du principe aux personnes morales soulève des difficultés spécifiques, notamment en cas de fusion-absorption. La Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence en admettant le transfert de la responsabilité pénale à la société absorbante (Crim. 25 novembre 2020).
Cette évolution pose la question de l’application de la loi pénale plus douce dans ce contexte particulier.
Articulation avec le droit de l’Union européenne
L’influence croissante du droit de l’Union européenne en matière pénale soulève de nouvelles questions quant à l’application du principe de rétroactivité in mitius. La Cour de justice de l’Union européenne a reconnu ce principe comme faisant partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres (CJUE, 3 mai 2005, Berlusconi).
Cependant, l’articulation entre le droit national et le droit de l’Union peut s’avérer complexe, notamment lorsqu’une directive pénale laisse une marge d’appréciation aux États membres dans sa transposition.
Vers une constitutionnalisation du principe ?
Bien que fermement établi en droit français, le principe de rétroactivité in mitius n’a pas de valeur constitutionnelle explicite. Le Conseil constitutionnel ne l’a reconnu qu’indirectement, en le rattachant au principe de nécessité des peines inscrit à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.
Une consécration constitutionnelle explicite pourrait renforcer la protection de ce principe fondamental et clarifier son statut dans la hiérarchie des normes.
En définitive, l’application de la loi pénale plus douce en cours de procédure demeure un principe vivant, en constante évolution. Son importance dans la protection des droits fondamentaux et la garantie d’un procès équitable n’est plus à démontrer. Les défis à venir consisteront à adapter ce principe aux nouvelles réalités du droit pénal, tout en préservant sa cohérence et son efficacité.
